
Yod de Bruno Giner (entretien)
Entretien avec Bruno Giner, par Serge Bertocchi : paru en mai 1994 dans le n° 44 des bulletins de L’Association des saxophonistes français.
Serge Bertocchi : Comment en es-tu arrivé à écrire pour saxophone ?
Bruno Giner : A priori, le saxophone était un instrument qui ne m’attirait pas beaucoup, et ce pour plusieurs raisons. D’une part, son répertoire habituel, essentiellement composé de pièces néo-classiques, ne m’intéresse pas du tout. D’autre part, son répertoire récent relève souvent plus du catalogue d’effets que de l’incarnation sonore d’une pensée musicale solide et structurée. Dans les deux cas, malgré d’indéniables réussites qui ne font que confirmer la règle, la littérature pour saxophone me semble légère et un peu creuse…
S. B. : Tu penses qu’il faut d’abord rechercher un principe esthétique plutôt que la nouveauté, par exemple au niveau des modes de jeu, des plans sonores…
B. G. : Bien sûr ! Modes de jeu ou « techniques nouvelles » ne sont que des éléments de vocabulaire parmi d’autres. En soi un growl n’est pas syntaxique ; par contre sa fonction à l’intérieur d’une phrase ou d’une séquence peut l’être.
S. B. : La règle s’applique d’ailleurs tout autant à une note tenue ou vibrée… C’est le contexte qui donne à un élément sa place et sa valeur dans le discours.
De nombreuses pièces ont été écrites pour saxophone ces vingt dernières années. Penses-tu que l’on commence maintenant à maîtriser la syntaxe des nouveaux modes de jeu, ou restent-ils tout simplement des effets de mode ?
B. G. : À partir du moment où ces modes de jeu ont commencé à être répertoriés, codifiés et fiabilisés techniquement, les compositeurs ont peut-être eu tendance à se précipiter dessus et à les utiliser au détriment d’une cohérence syntaxique globale (qui n’est d’ailleurs pas dans la tradition du répertoire du saxophone).
S. B. : Il y a donc un problème de formalisation dans le répertoire général, passé ou récent…
B. G. : Ce qui n’exclut pas les pièces réussies, qui démentent heureusement mes propos ! Je crois en fait que le répertoire du saxophone est en pleine évolution, et qu’un niveau d’exigence va se créer progressivement, tant au niveau des compositeurs qu’à celui des interprètes.
S. B. : Malgré tous ces problèmes liés au répertoire, tu as écrit une pièce pour saxophone…
B. G. : Oui ! Mais j’ai quand même mis deux ans à l’écrire, depuis le moment de notre rencontre ! Il m’a fallu du temps pour me faire à l’idée (rires) ! Après quelques discussions, nous étions tombés d’accord pour consacrer la pièce au saxophone baryton, et j’avoue que c’est une des raisons qui m’a vraiment intéressé. Chaque saxophone ayant ses spécificités, le fait d’écrire pour baryton m’a beaucoup aidé : un répertoire quasiment vierge, une incroyable richesse de possibilités sonores, un registre étendu, des couleurs particulières…
S. B. : Nous nous sommes aperçu d’ailleurs que si l’on veut une pièce résolument saxophonistique, il est difficile de la concevoir de manière polyvalente, jouable sur plusieurs instruments de la famille.
B. G. : Tout à fait ! Si on se penche vraiment sur tel ou tel saxophone, en tenant compte des idiomatismes propres à chacun, on se rend vite compte que de nombreuses choses ne sont pas adaptables, soit par impossibilité technique, soit par le manque d’intérêt même de l’adaptation. Il est vrai aussi que nous avons effectué un gros travail sur les possibilités spécifiques au baryton.
S. B. : Justement, parle nous de la composition de « Yod »
B. G. : Le temps de réalisation a été assez long, souvent entrecoupé par d’autres travaux. J’ai eu besoin de me familiariser avec l’instrument, d’assimiler en profondeur nos séances de travail, pour ne pas me précipiter sur le premier effet venu ou bienvenu… C’est une pièce à laquelle j’ai travaillé de manière inhabituelle, hachée, fractionnée dans le temps… Beaucoup d’esquisses…
S. B. : Il y a eu plusieurs versions successives… Penses-tu que l’absence de repères historiques rende la tâche du compositeur plus difficile ? Que le résultat sonore est différent de celui auquel on s’attendait, et que l’on doive y revenir ?
B. G. : Je ne crois pas. Les quelques changements intervenus entre la création et la version définitive étaient plutôt dus au problème formel et musical que j’ai voulu assumer dans la pièce, et qui n’était pas évident. Ne voulant pas tomber dans le piège du catalogue d’effets, je me suis fixé un certain nombre de règles très contraignantes.
Toute la pièce est basée sur une courte figure de neuf notes à laquelle je n’ai pas voulu appliquer les diverses techniques d’expansion et de prolifération : je m’en suis tenu à une exploitation minimale, un peu carcérale.
La première section de la pièce, par exemple, s’en nourrit entièrement. Musique assez violente, mais qui tourne en rond, n’aboutissant ni sur un « climax », ni sur une résorption complète ; c’est une chose en soi, qui essaie de sortir de ses limites sans vraiment y parvenir. La figure initiale subit une exploitation maximale, avec un minimum de transformations (sans que cela soit répétitif pour autant).
D’autre part, j’ai essayé de traiter un élément nouveau dans mes préoccupations : la mélodie. Comment écrire une mélodie, et comment l’intégrer organiquement à la forme ?
S. B. : Il semble que le souci d’un nouveau mélodisme soit effectivement une préoccupation assez générale pour de nombreux compositeurs aujourd’hui…
B. G. : Oui, mais les approches peuvent être différentes. Debussy, Wagner, Poulenc et Webern ne m’ayant pas fourni de solutions utilisables dans mon langage, je les ai plutôt recherchées dans les musiques extra-européennes. Quels sont les archétypes de la mélodie ? J’aurais tendance à répondre (pour l’instant) : brièveté, répétition, détempérament, variations mélodiques et rythmiques très fines.
S. B. : D’où les nombreux micro-intervalles… S’agît-il pour toi de reproduire un folklore, même imaginaire ?
B. G. : Pas du tout ! Pas d’imitation directe, et encore moins de citation : le propos n’est pas ethno-musicologique. De plus, je suis loin d’être un spécialiste des musiques extra-européennes. Nous nous trouvons dans une tradition musicale occidentale et… savante, ce que revendique totalement. Mais si à un moment donné, celle-ci s’avère impuissante à me fournir des solutions, je n’hésite pas à faire appel à d’autres traditions musicales : il ne faut pas avoir les oreilles fermées, mais il ne faut pas non plus chercher à tout mélanger, à tout mettre sur le même plan (le côté « World Music » à la mode dans certaines musiques contemporaines m’est assez insupportable…).
S. B. : Quant à la forme ?
B. G. : Toute la pièce est formalisée très strictement. Peut-être trop au départ, car je ne m’étais autorisé aucune souplesse d’écriture. L’idée générale était d’écrire pour saxophone avec autant de rigueur que pour piano ou quatuor à cordes…
Ce n’est qu’une fois la pièce achevée dans ce réseau de contraintes rigoureuses que je me suis rendu compte avec plaisir qu’elle pouvait supporter une certaine souplesse quant à l’agencement de certaines sections : du coup, j’ai volontairement oublié le plan initial afin de prendre localement quelques décisions qui me semblaient nécessaires et bienvenues.
S. B. : J’ai effectivement été étonné de la facilité avec laquelle on pouvait faire pivoter certains éléments dans le temps sans détruire la cohérence musicale de la pièce telle que je la ressentais.
B. G. : Tout ce qui est fortement architecturé continue à tenir debout même si on permute ou enlève tel ou tel élément – à condition que ce ne soit pas un mur porteur -, cela relève plutôt de la décoration ou de l’aménagement intérieur.
S.B. : Tu pourrais peut-être nous parler du titre ?
B. G. : Dans la Kabbale, Yod est la dixième lettre de l’alphabet, mais également le chiffre dix. Yod (10) renvoie à Aleph (1) qui, au niveau symbolique, est la figuration du principe abstrait de tout ce qui est. Aleph est intemporel, discontinu, immanence créatrice au-delà de toute pensée. Au niveau métaphysique, cela peut représenter de l’idée musicale en soi, non exprimée, non réalisée. Yod, correspond à la projection d’Aleph et exprime une continuité d’existence de caractère temporel, manifestation concrète d’Aleph. Si ce dernier peut symboliser l’idée musicale, Yod en serait la réalisation, il est la concrétisation de l’énergie créatrice abstraite.
S. B. : (A parte… je me suis fait ré-expliquer ça 2 fois…) Tu es Kabbaliste ?
B. G. : Pas du tout, mais je m’intéresse à la symbolique en général. Cela me sert de stimulus pour écrire ou pour formaliser tel ou tel élément.
S.B. : Est-ce que tu peux relier « Yod » à d’autres pièces de ta production ?
B. G. : Je crois qu’on retrouve le même engagement d’énergie dans toutes mes pièces ; pas seulement basée sur la puissance, mais aussi sur des choses plus douces, qui ne signifient pas une détente, mais une énergie diffusée autrement.
S. B. : Pour conclure, que suggèrerais-tu à un saxophoniste qui, comme toi, penserait que son répertoire est un peu pauvre ? Quelle démarche pourrait-il avoir ?
B. G. : J’aurais tendance à être assez radical… Quelle que soit l’époque et le type d’esthétique à considérer, les interprètes en général, et les saxophonistes en particulier, devraient être exigeants quant à la qualité des pièces qu’ils choisissent de jouer, en priorité par rapport à la musique, et non par rapport à l’instrument.
S. B. : Pour toi, si une pièce sonne bien, cela ne te suffit pas ?
B. G. : Les bons registres aux bons endroits et au bon moment… c’est nécessaire mais pas suffisant : tout bon artisan peut écrire une pièce qui « sonne ». Le problème est plutôt de l’ordre de l’idée musicale, qui peut être intéressante ou pas, bien ou mal assumée. N’oublions pas que la musique est une pensée qui s’incarne par les sons.
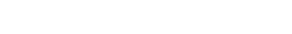
Cliquer sur cette image pour accéder au site du compositeur.


